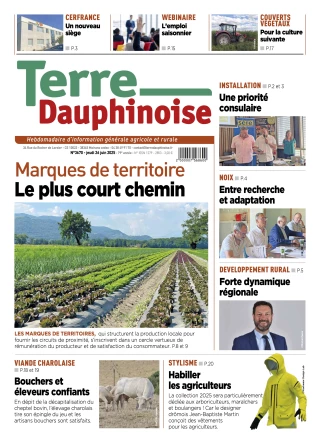Construction en pisé : un patrimoine d'avenir

Maisons, fermes, granges, séchoirs, mairies, écoles, chapelles… En Dauphiné, dans le Lyonnais ou le Bugey, les constructions en terre crue se fondent si bien dans le paysage que l’on en oublierait presque de les regarder comme des trésors patrimoniaux. Un patrimoine souvent malmené, parfois disparu sous de médiocres enduits ou restauré de façon maladroite, mais bel et bien vivant. Dans le Nord Isère notamment, où 75% de l’habitat ancien est en pisé, la construction en terre n’a rien de folklorique. Elle s’intègre même dans des projets contemporains, qu’il s’agisse de logements ou d’équipements publics comme cet audacieux groupe scolaire construit à Veyrins-Thuellins par une entreprise iséroise avec de la terre locale extraite à cinq kilomètres du chantier…

Béton de terre
Utilisée depuis la plus haute Antiquité, la construction en pisé est très répandue dans nos campagnes, car elle a longtemps représenté le système le plus simple et le moins onéreux. Elle consiste à prélever des mottes juste en dessous de la terre arable (1), à les casser afin de pouvoir « frasser » la terre (la répartir en fines particules), puis à l’humidifier pour ensuite la déverser et la tasser dans des coffrages. Pendant des siècles, la technique n’a guère évolué. Mais à la veille de la Révolution, elle a fait un véritable saut technologique grâce à l’invention du bloc de terre crue comprimé. Ce « nouveau pisé », sorte de béton de terre mis au point par François Cointeraux (1740-1830), connaîtra un succès quasi planétaire : on le retrouve un peu partout en Europe et au-delà des mers, jusqu’aux Etats-Unis ou en Australie. Las, au XXème siècle, et plus particulièrement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la technique est tombée en désuétude, tant à cause de la disparition d’un certain savoir-faire qu’en raison de l’ascendance des systèmes constructifs modernes (béton, acier, préfabriqué…) sur les techniques traditionnelles.
Mais l’architecture de terre crue n’a pas disparu pour autant des paysages dauphinois. Depuis la fin des années 70, associations, architectes, bureaux d’études et équipes de recherche, comme le laboratoire CRAterre à Grenoble, œuvrent en faveur de ce matériau de construction, qui reste aujourd’hui l’un des plus répandus au monde (2). En Isère, l’opération la plus importante - le Domaine de la terre - est sorti de terre en 1985 dans le contexte stimulant de l’émergence de l’Ile-d’Abeau-ville nouvelle. A l’époque, cet ensemble de logements sociaux en pisé se voulait une réalisation pilote, destinée à susciter d’autres chantiers innovants de ce type. Sans trop de succès. Pourtant, contrairement à ce que les esprits chagrins prédisaient à l’époque, ce quartier expérimental d’habitat urbain, unique en Europe, est toujours debout aujourd’hui. Ses habitants sont même très heureux d’y vivre, comme en témoigne le faible turn over des locataires.

Améliorer les techniques et les matériaux
Il n’en faudra pas moins attendre le début du XXIème pour que la terre crue apparaisse comme une piste de recherche intéressante au regard des enjeux actuels en termes de développement durable. Et qu'elle commence à attirer l’attention des élus. Dans le Pays voironnais, les Vallons-de-la-Tour ou sur le territoire de la CAPI, des projets et des chantiers de réhabilitation du bâti ancien sont en cours d'étude. Cette sensibilité nouvelle s’explique en partie par l’évolution des techniques. « Jusqu’à présent, on avait beaucoup travaillé sur les techniques anciennes, indique Thierry Joffroy, architecte et président du laboratoire CRAterre. Mais, économiquement, ce n’est pas viable. Si on reste trop traditionnel, il faut trop de main-d’œuvre et le coût de la construction est trop élevé. Sans compter que les performances techniques ne correspondent plus normes actuelles. Voilà pour quoi nous axons nos recherches sur de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux, avec des fibres à l’intérieur, afin de les rendre plus légers et plus isolants. Il existe une clientèle intéressée, le marché existe, mais la filière n’est pas encore assez organisée pour faire baisser les coûts de façon significative. » De fait, la construction en pisé, populaire autrefois parce que facile à mettre en œuvre et peu onéreuse, est aujourd’hui devenue un luxe pour rurbains écolos. Un paradoxe que les adeptes de la construction en terre – architectes, entrepreneurs ou artisans - travaillent à réduire en poussière.
Marianne Boilève
(1) Les terres à pisé sont composées d’un mélange de gravier, de sable, de limon et d’argile en proportion variable.
(2) 40% des habitats actuels dans le monde sont en terre crue.
Parcours de terre
18 septembre à VoironTerres contemporaines : à quoi ressemble l'architecture en terre crue au XXIe siècle ? Une conférence qui interroge l’architecture contemporaine internationale en terre crue, zoom sur l’Europe et la France. Animée par Anne-Lyse Antoine, architecte spécialisée dans l’architecture de terre. Médiathèque Philippe Vial, 5, boulevard Edgar Kofler. De 19h à 20h30. Gratuit. 19 septembre à L’Ile-d’Abeau
• Atelier Grains de bâtisseurs, animé par CRAterre, référence mondiale dans le domaine de l'Architecture de terre. Comprendre comment passer d’un tas de terre à un mur. Petites expériences scientifiques, simples, ludiques voire spectaculaires à destination du grand public. Mairie de l’Ile-d’Abeau de 10 h à midi. Gratuit. Atelier accessible en fauteuil roulant.
• Les techniques de construction en terre crue dans l'architecture contemporaine. Parcours-conférence animé par Mathilde Béghin, architecte spécialisée dans la construction en terre crue. Mairie de l’Île d’Abeau à 18 h. Atelier accessible en fauteuil roulant. 19 et 20 septembre à Villefontaine
Visite libre du Domaine de la terre, un ensemble architectural mêlant innovation, expérimentation et tradition dauphinoise. 20 septembre à Massieu
Au cœur de la Valdaine, ce village tout en longueur est riche d'un patrimoine bâti marqué par une architecture terre. Visite avec un guide conférencier de 16h à 17h30. Gratuit.