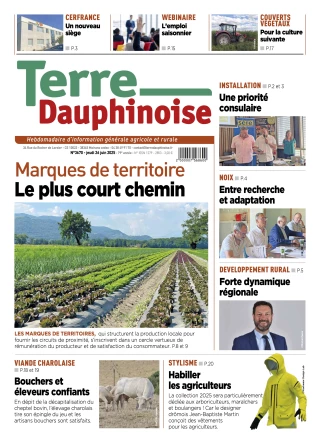Dentelles dans la forêt

Ils font tout pour que leur travail ne se voit pas. C'est à cette règle d'humilité que les exploitants forestiers cherchent à s'astreindre. Une visite de chantier organisée par la charte forestière du Bas-Dauphiné et Bonnevaux, cet automne à Arzay, était là pour le démontrer. Philippe Garde de la coopérative forestière Coforêt a expliqué à la trentaine d'élus locaux ou de professionnels du bois présents les grands principes d'intervention dans la propriété visitée. « Nous procédons par trouée, explique le technicien forestièr. C'est une coupe à blanc sur 1 000 m2. Nous en pratiquons seulement deux à l'hectare, tous les 7 à 8 ans. Au bout de trois ans, on aperçoit à peine la coupe effectuée. » La propriété de 50 hectares concernée est essentiellement composée de taillis sous futaie. L'objectif à terme selon le gestionnaire est d'aboutir à une futaie irrégulière. « En pratiquant ainsi, on donne de la lumière aux arbres et on permet une régénération naturelle de la forêt par un ensemencement à partir des arbres restant autour, explique Philippe Garde. Si on coupait à blanc sur de vastes espaces, il y aurait reconquête par des espèces de reconquête : ici on aurait du genêt et du tremble, alors que la végétation en place est plutôt du chêne, des hêtres, des érables quelquefois de douglas dont les graines sont portées par le vent. C'est ce mélange de bois de qualité que nous recherchons. »
L'opération, même si ce n'est jamais suffisant au goût des propriétaires, rapporte un peu dans la mesure où il y a tri lors de la coupe. L'essentiel part en bois énergie, plaquette ou bûches, mais il y a quelques bois d'oeuvre qui peuvent être enlevés et éventuellement lorsqu'il y a du châtaigniers ou du robinier, une valorisation en piquet. Mais les volumes doivent être raisonnés en regroupant plusieurs chantiers de ce type à proximité. « L'accès volontairement restreint pour effectuer la trouée ne sert qu'une fois, explique le technicien. Nous n'y repasseront plus, afin de préserver l'endroit et de ne pas dégrader les sols. Nous travaillons donc avec de petits engins et regroupons les bois sur des plateforme créées plus loin dans le but de concentrer le travail sur place. »
Gros engins
L'organisation de tels chantiers doit être cohérente et mobiliser les entreprises spécialisées pour des volumes importants, seule voie pour que l'exploitation soit rentable. Ainsi, une plateforme accueillent les fûts extraits des parcelles à proximité, et permet l'accès d'un gros broyeur de la société Bois des Alpes. L'engin automoteur, énorme, d'une puissance de 700 cv peut traiter 50 tonnes de bois à l'heure. « Il ne faut pas avoir peut d'une telle puissance, tient à rassurer Yannick Peillard, P.Dg de Bois des Alpes. Le moteur travaille à plein régime sans perte de tours/minute qui engendrerait une qualité irrégulière des plaquettes que nous générons. La régularité de l'approvisionnement permet un diamètre constant des plaquettes que nous pouvons adapter aux différentes demandes grâce à un changement de grille. Ainsi, les différentes chaufferies au bois que nous livrons reçoivent le produit qui leur convient le mieux. » Et la présence d'une telle machine ne nuit pas à la forêt puisqu'elle ne traite que les bois sortis des parcelles. Aux techniciens de les gérer.
Implication municipale
Si le bois énergie, ou une exploitation des forêts locales pour le bois-d'oeuvre ont le vent en poupe auprès des collectivités, des habitants ou des politiques nationales ou régionales, la concrétisation de ces objectifs dans les forêts provoquent quelquefois l'émoi des promeneurs. Et ceux-ci se tournent vers leur interlocuteur naturel : le maire. En l'occurence, Lilianne Terrol, premier magistrat d'Arzay. Très à l'écoute et avide de connaissances, elle s'est faite porte-voix de nombreux élus locaux interpellés régulièrement par des habitants inquiets d'une coupe à blanc, « d'une destruction, voire d'une disparition de la forêt ». Gwenaelle Scolan, directrice de Créabois, l'interprofession iséroise du bois, s'est montrée rassurante. « L'objectif est une exploitation des ressources avec un renouvèlement et une amélioration des peuplements. Le feuillus en particulier a toute sa place localement mais aussi dans la région car il y a des unités de transformation locales qui savent le travailler. » Mais pour pouvoir intervenir, il faut des conditions économiques correctes, c'est l'objet des différentes démonstrations. Travailler par petites places ne défigure pas mais tire le bois sans intérêt des forêts pour la faire évoluer. Grouper des chantiers permet de mobiliser à bon escient des volumes donc de déplacer des engins et des hommes avec suffisamment de rentabilité. Mais encore faut-il que les conditions extérieures soient réunies, notamment l'accès. Les élus ont donc été sensibilisés à la nécessité de prévoir des accès suffisants et une réglementation adaptée. Si les chemins locaux sont limités en tonnage, il n'y aura pas d'extraction de bois, donc pas de valorisation d'un patrimoine naturel. De la même manière, les plateforme de tri peuvent être prévues sur les parties communales des forêts. Elles sont plus facile à mettre en oeuvre. Car les professionnels l'affirment : une forêt inexploitée vieillit, se dégrade. Les vieux arbres tombent. Quant aux craintes de changement de destination des sols, il est anecdotique. Les forêts sont implantées sur des sols qui ne pourraient pas être valorisées autrement. Dans les Bonnevaux, il y a peu de sol et beaucoup de terrains humides. Personne ne veut les changer.