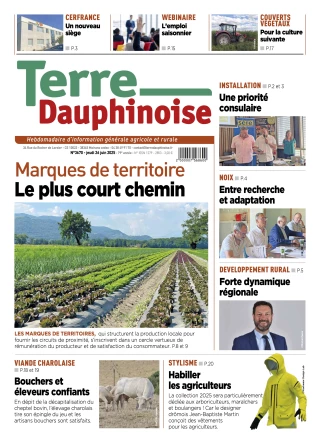Ensauvagement et financiarisation

A qui profite le loup ? Lors de leur session montagne à Méaudre, les JA se sont interrogés sur la façon de gérer le loup différemment.

Ils ont fait appel aux connaissances des scientifiques qui depuis 26 ans étudient l'évolution du loup en France. Ils constituent le réseau Coadapht(1) piloté par le chercheur de l'Inra Michel Meuret, réseau qui vient de publier une synthèse des études menées sur le sujet depuis 20 ans par l'Inra, le CNRS et le Cerpam(2).

Pour les éleveurs, le constat est amer. « On subit, on ne sait pas comment s'en sortir. Le dossier n'avance pas. Veut-on encore de l'élevage intensif ou du tout extensif ? », interroge Edouard Pierre, référent loup JA national.
Ce qu'analysent les chercheurs, c'est que le loup « est un être vivant extrêmement subtil et adaptable, qui réagit aux politiques mises en œuvre. A partir du moment où on le protège, il perd la crainte de l'homme et apprend à aller sur les troupeaux. Alors qu'un loup régulièrement chassé est beaucoup plus craintif et s'en prend moins aux troupeaux », résume l'écologue Laurent Garde, directeur adjoint du Cerpam, membre du Coadapht.
95% des attaques sur des troupeaux protégés
11 700 animaux prédatés en France en 2017, une population de loups qui évolue de façon « exponentielle » (+20% par an), tous les observateurs s'accordant à reconnaître que le seuil des 500 loups est aujourd'hui atteint, une soixantaine de meutes installées dans le massif alpin qui se densifient, des attaques qui surviennent à 95% sur des troupeaux protégés (filet, chiens, gardiennage) : les scientifiques ne peuvent que constater « que le loup a pris ses aises ».
« Une politique uniquement basée sur la protection des troupeaux est vouée à l'échec », reprend Laurent Garde. Elle doit être associée à une politique de régulation « et d'élimination systématique d'individus et de meutes qui posent problème ».
« Les loups qui vivent comme des loups sauvages ne posent pas de problème », ajoute le sicientifique.
Emissaire de lui seul
La députée de la 4e circonscription, Marie-Noëlle Battistel, qui a été présidente de l'Anem(3) et est membre du groupe loup à l'Assemblée nationale, dénonce une politique qui ne permet de prélever que 50 loups par an, alors que la population s'accroit d'une centaine, laissant le champ libre à « un développement démesuré ».
Par ailleurs, elle n'a pas caché sa colère en apprenant que la France avait envoyé un émissaire pour s'opposer au changement de statut du loup, lors du comité permanent de la Convention de Berne qui s'est déroulé en fin de semaine dernière.
Qui représentait-il ? Les JA s'interrogent sur cet étrange fonctionnement démocratique.
Safaris sauvages
« Aujourd'hui, le contrat rural est rompu au profit d'un projet alternatif qui est l'ensauvagement, avance Laurent Garde. Nous sommes à la porte d'un phénomène massif qui commence à se nommer. »
Il cite en exemple le Contrat de transition écologique (CTE) biodiversité, porté par le ministère afférant, signé à Grasse, en lien avec le parc naturel régional Préalpes Azur, projet d'ensauvagement d'un territoire, prémices d'un tourisme de safari.
« Une société citadine a besoin du fantasme d'une nature sauvage, décrypte l'écologue. Le débat de société oppose un rural vivant à la nature sauvage et imposée. »
Dans le Vercors, l'Apas (4) porte un projet d'ensauvagement du même type, sur 500 hectares, pour en faire une réserve de vie sauvage en lien avec le réseau Rewilding Europe, dont les activités comptent entre autre, une banque d'investissement et une société proposant des safaris sauvages.
« Il s'agit d'une financiarisation de la nature », dénonce un membre de JA en s'interrogeant sur le financement de telles opérations.
Certaines entreprises ne pourraient-elles pas bénéficier de tels dispositifs sur fond de réforme des droits à polluer, via la création de fonds financés par la vente de quotas d'émission de CO2 ?
Gestion différenciée ?
Cette interrogation fait écho à la question de la gestion différenciée du loup en fonction des territoires.
Elle avait été écartée de justesse du plan loup, mais certains élus militent encore pour cette mesure.
L'objectif : intervenir sur les fronts de colonisation pour éviter l'expansion du loup dans des secteurs non protégeables (comme l'Aveyron et son million de moutons qui représenterait un gouffre financier en mesures de protection et d'indemnisations)... et laisser le prédateur se développer dans les Alpes.
Le principe fait hurler les éleveurs.
Pierre-Yves Bonnivard, le président de l'Usarp(5), rappelle que le problème du loup et de la prédation « est surtout un problème entre le monde rural et le monde urbain ».
« La méconnaissance crée la défiance et des lois qui ne sont pas adaptées aux gens qui les subissent », estime un autre JA.
Portant le problème à bout de bras, les élus de l'Usapr ont lancé en octobre dernier l'Appel de Buis-les-Baronnies pour « Mettre fin à la pression insupportable des grands prédateurs pour des territoires ruraux respectés et vivants ».
Isabelle Doucet
(1) Réseau de chercheurs sur la coadaptation des prédateurs et des humains
(2) Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée
(3) Association nationale des élus de montagne
(4) Association de protection des animaux sauvages
(5) Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales
Lire aussi sur terredauphinoise.fr :
- Plus d'attaques, moins de victimes
- Le loup, dossier noir de l'Europe
- Le loup, en forte expansion démographique