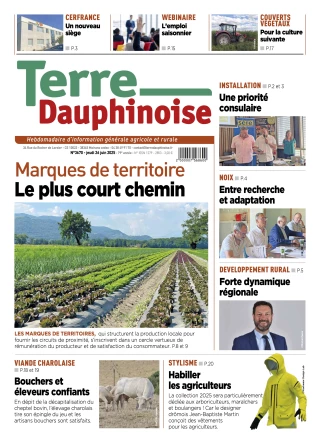L'aménagement des fins de carrière

« On n'est pas des mineurs », fait remarquer André Coppard, secrétaire de la chambre d'agriculture de l'Isère en charge des dossiers infrastructures et protocoles. Dans la région, le retour à l'agriculture des parcelles exploitées par les carriers a longtemps laissé un goût d'insatisfaction dans le monde agricole. Manipulés, tassés, en fond de carreau, les sols ne retrouvaient pas leurs rendements. Granulats Vicat est allé jusqu'au fond de la question, recrutant une agronome, Camille Bayle, pour élaborer un protocole de remise en état des sols qui donne satisfaction à l'ensemble des partenaires. C'est chose faite puisque le carrier vient de signer une convention avec la chambre d'agriculture de l'Isère, la commune de Creys-Mépieu et l'association Lo Parvi pour la remise en état agricole des terrains exploités en carrière sur le site de Faverges en nord Isère. Les premières cultures de production ont été semées cette année sur 5 000 m2. Il s'agit d'une orge de brasserie implantée en partenariat avec la brasserie du Lion. L'emprise du site de Creys-Mépieu s'étend sur 43 hectares, mais seuls cinq hectares sont mobilisés pour l'extraction du granulat et 5 000 m2 de terres sont dites en convalescence.

Fond de carreau
Granulat Vicat s'est penché sur le problème depuis 2007, expérimentant sa démarche volontaire sur le site de Nievroz dans l'Ain. « Nous avons essayé plusieurs protocoles avant de recruter en 2011, une ingénieur de l'Isara en alternance pour travailler sur la partie agronomique », explique Maurice Rethore, directeur des carrières Granulats Vicat en région lyonnaise et initiateur du projet. Au bout de trois ans de bonnes pratiques, les rendements sont de retour dans l'Ain : pour 75 qtx/ha d'orge d'hiver attendus, les sols en ont livré 82 cette année ! La méthodologie, affinée par le carrier a donc été validée et a fait l'objet d'une première convention, signée en juin 2014, base sur laquelle s'est appuyé l'accord isérois.

« A Faverges, il a fallu restituer un horizon agricole en fond de carreau, reprend Maurice Rethore, il n'y avait pas de matériaux pour remblayer à la cote naturelle. » Ganulats Vicat a acquis une expérience technique, mais aussi humaine. Un dossier de remise en état de carrière ne peut réussir que s'il est « Coconstruit. » « Nous devons intégrer toutes les parties prenantes au dossier et ensuite faire quelque chose de fonctionnel tant sur le plan agronomique qu'environnemental, sans sanctuariser l'un ou l'autre des volets », insiste Maurice Rethore. A Faverges, les relations avec le monde agricole ont été d'autant plus simples que nombre d'exploitants appartiennent à la même Cuma... celle de Faverges. « Au moment de récupérer les parcelles, il est nécessaire que tout le monde s'entende. Il faut donc travailler collectivement, en créant un comité de suivi », insiste André Coppard. C'est pour cette raison que la chambre d'agriculture de l'Isère a trouvé un intérêt à s'impliquer dans de tels dossiers. « C'est un travail nouveau », reconnaît André Coppard, mais extrêmement porteur car le savoir-faire acquis est reconductible, dans un paysage où les carrières sont nombreuses et la règlementation, notamment à travers le schéma régional d'exploitation des carrières fixé par la Dreal, à tendance à se complexifier. « Le cadrage régional demande la réduction de l'exploitation des gisements alluvionnaires en eau. A terme, nous serons de plus en plus confrontés à ce type de remise en état sur des gisements hors eau. Nous devions anticiper les choses », ajoute Maurice Rethore. Le projet d'extension de la carrière de la plaine de Faverges fait l'objet d'une enquête publique jusqu'au 20 mai.
Convalescence
Désormais codifié, le mode opératoire consiste en des études préalables portant sur l'analyse des sols. Au décapage, les horizons minéraux sont séparés de la terre végétale. Le principe est de stocker la terre le moins longtemps possible, la restauration de la carrière avançant en même temps que son exploitation. Après la phase d'exploitation du gisement, le fond de fouille est nivelé et décompacté pour la remise en place sélective des matériaux de découverte. Les terrains sont ensuite restitués et observent une période de convalescence. Au terme de celle-ci, ils sont à nouveau propres à recevoir une culture de production agricole.

A 10 mètres en dessous de la cote initiale, lorsque la carrière n'a pas pu bénéficier d'un remblai comme c'est le cas à Faverges, tout un travail sur les talus et leur inclinaison à 20° est réalisé. Là une prairie mellifère accueille des ruches et des moutons, chargés de l'entretien et de détruire l'ambroisie. Le nord Isère étant largement soumis à la pression des plantes invasives, même les tas de terre sont ensemencés de trèfle ou de ray grass en attendant leur remise en place.
.jpg)
D'autres sites devraient pouvoir bénéficier de l'expertise développée par Vicat et dont la chambre d'agriculture se fait désormais l'écho. C'est notamment le cas de la carrière d'Izeaux.
Isabelle Doucet

Trois questions à Camille Bayle, ingénieur agronome chez Vicat
Quelle méthodologie avez-vous appliquée ?La base de toute remise en état de carrière est le livre de « Le réaménagement agricole des carrières de granulats ». L'ouvrage recense les bonnes pratiques. En revanche, il n'y a jamais eu de retour d'expérience. Or il y avait des manques. De son côté, Granulats Vicat bénéficiait déjà de trois années d'expérience dans le réaménagement de carrières sur le site de Nievroz, dans l'Ain où il s'agissait d'améliorer la remise en état. Lorsque je suis arrivée en 2011, il y avait eu un terrassement, la remise en place des matériaux et la reconstitution de la parcelle agricole. Après 2011, nous nous sommes davantage intéressés au volet agronomique. Nous avons validé de nouveaux protocoles de terrassement, procédé à une expertise du sol, mis en place des couverts végétaux car le génie végétal apporte beaucoup à la structure du sol et accompagné les agriculteurs.Quels sont les points clés à respecter ?
Avant l'exploitation du terrain, on procède à l'expertise du sol avec une étude agronomique pour en connaître la fertilité et les différents horizons. On évalue ensuite comment décaper les matériaux. La terre végétale est retirée sur environ 40 cm et stockée seule. Les horizons, en dessous de la terre végétale sont séparés ou non selon leur qualité. Il faut intervenir dans des conditions les plus optimales possibles. Par exemple, les travaux de terrassement auront lieu en été ou pendant les périodes sèches. Il faut attendre que le sol se ressuie sinon, les matériaux se tassent. Après l'exploitation de la carrière, une fois arrivé en fond de carreau, les matériaux sont remis dans l'ordre initial. Puis on implante des engrais verts, qui restent en place pendant un à deux ans. Ce sont des légumineuses comme la phacélie, la vesce, le trèfle, le radis fourrager ou la féverole. Après cette période de convalescence, où le couvert a permis de restructurer le sol et apporter de nouveau une vie biologique et des matières organiques, le sol est prêt à accepter de nouveau une culture économiquement valorisable, il est possible de revenir à la culture d'avant l'exploitation.Et maintenant ?
Ce nouveau protocole s'est concrétisé par un guide de bonnes pratiques où sont reprises toutes les phases clés de la remise en état, en remontant avant l'exploitation de la carrière. Cet outil sert à former et sensibiliser tous les opérateurs qui travaillent sur les remises en état agricoles. De nombreux projets de recherche et d'échange se dessinent, au sein de l'Unicem* et avec d'autres carriers. Les prochaines carrières remises en état seront celle de Pérouges dans l'Ain et de Barraux en Isère, mais aussi celle de l'Armailler dans la Drôme, qui devrait faire l'objet d'une nouvelle convention avec la chambre d'agriculture.*Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

Le Cadre régional « matériaux et carrières » Rhône-Alpes de mars 2013
L'Isère est le département qui recense la plus grande capacité d'extraction de matériaux autorisée (23 millions de tonnes pour 86 millions autorisés en région). La production réelle dépasse 12 millions de tonnes en 2008. La moitié des carrières alluvionnaires sont en eau. Ce schéma préconise la réduction de l'exploitation des carrières en eau et privilégie l'extension des sites existants.
Sur la question agricole, il stipule : « L'exploitation des gisements de matériaux doit se réaliser dans la perspective du maintien de l'activité économique agricole à la fois au niveau des surfaces et de la fonctionnalité des exploitations agricoles. À ce titre, toute consommation de foncier agricole doit être évitée ou réduite dans le cadre de l'exploitation et du réaménagement des carrières. » Il dit aussi : « Selon les sites, les remises en état agricoles peuvent participer à la conservation de la biodiversité. Sur les sites à enjeu écologique, il conviendra d'associer les associations de protection de la nature au suivi des mesures mises en place ».