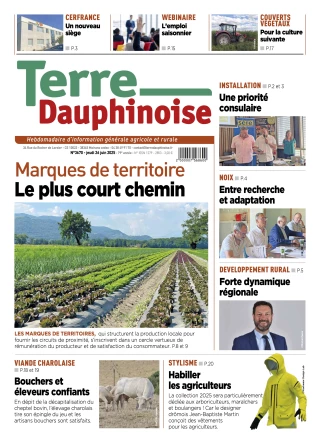Les alpages, indispensables mais fragiles

La journée est traditionnelle chez les alpagistes. Chaque année, ils se retrouvent dans l'un des alpages de l'Isère afin à la fois d'échanger sur leurs pratiques et leurs difficultés, mais aussi de partager un moment convivial. La rencontre organisée cette année par la Fédération des alpages de l'Isère (FAI) a eu lieu le 3 août dans l'alpage des Allières situé au cœur du territoire de Lans-en-Vercors. Et comme ce n'était pas qu'un moment convivial, la directrice départementale des territoires, Marie-Claire Bozonnet, assistait aux échanges.

Reconquête
Les éleveurs tiennent à leurs alpages. Loïc Duchêne, jeune président de 33 ans du groupement pastoral des Allières, le rappelle. Même s'il ne couvre que 350 hectares et deux secteurs séparés et qui ne communiquent pas, cet alpage exclusivement bovin accueille 170 génisses laitières ou viande provenant uniquement du Vercors. « Grâce au bleu du Vercors, nous assistons à une véritable dynamique économique, se réjouit-il. Mais si nous n'avions pas les alpages, nous manquerions de place. » Car dans le système d'exploitation local, comme dans de nombreuses montagnes, les bêtes en alpage libèrent autant de place plus bas pour faire du foin et préparer l'hiver. La dynamique est suffisante pour que les éleveurs aient même le projet de reconquérir des surfaces forestières. Car au fil des ans, depuis quelques décennies, le paysage de ces moyennes montagnes s'est transformé. C'est visible à l'alpage des Allières comme à celui du pic Saint-Michel, occupé par 1 600 ovins (1 000 brebis et 600 agneaux).

« Au-dessus du village, l'espace s'est considérablement fermé, raconte Pascal Ravix, le président du groupement pastoral de cet alpage. Cela prive de surface pâturable, mais l'avantage pendant les périodes de canicule comme cette année est d'offrir une ombre bienfaitrice à nos bêtes. » Un projet de reconquête est en réflexion avec les chasseurs locaux. Car si les arbres repoussent peu à peu les ruminants, ils chassent aussi une diversité sauvage souvent symbolisée par le tétras-lyre. Mais pas que. La reconquête de l'espace déjà opérée à certains endroits a fait réapparaître des lys martagon. Et pour le moment, les touristes profitent de tout cet espace semi-ouvert même s'ils ne se rendent pas toujours compte du travail permanent qui est mené localement.
Investissements réguliers
« Le bleu est une formidable tête de gondole pour notre territoire, s'enthousiasme Guy Charron, élu de Lans-en-Vercors. Nous l'avons bien compris et nous avons à cœur de défendre les alpages et les espaces agricoles dans nos documents d'urbanisme, notamment dans le PLUI. Ces secteurs d'estive ont une vocation multifonctionnelle entre la forêt, les alpages, le ski, le tourisme d'été. La volonté de les protéger est ancienne. » En vingt ans, 328 000 euros ont été investi par les collectivités dans les équipements de l'alpage des Allières : un chalet, une station de pompage et des abreuvoirs facilitent la vie des éleveurs et surtout des bergers présents. Des interventions nécessaires car même une année comme 2018 où la neige a été particulièrement abondante et les pluies importantes au printemps, en ce début d'août, la canicule fait ressentir ses effets. La plupart des responsables d'alpages présents le confirment. Dans de nombreux secteurs l'herbe « efficace » devient rare et certaines sources, quand il y en a, montrent des signes de faiblesses.
300 agneaux d'alpage

Si le bleu du Vercors est bien installé et permet de garder la valeur ajoutée localement, il est un autre produit qui prend peu à peu de l'ampleur : l'agneau d'alpage. Roland Bouvier, éleveur et président de l'association des viandes agro-pastorales était là pour faire un point. La saison de ce produit haut de gamme goûteux vient de commencer. « La période de commercialisation court du 15 août au 15 octobre, rappelle-t-il. La caractéristique de cet agneau est d'avoir eu une alimentation sous la mère ou en alpage avant de redescendre pour être abattu. » Cette période est donc nécessairement courte mais elle se poursuit par la dénomination agneau de nos fermes pour les bêtes qui ont brouté en plaine en automne ou ont été nourries au foin. « Cette année, nous prévoyons d'écouler une dizaine d'agneaux d'alpage par semaine pendant les dix semaines, auprès de quatre boucheries avec lesquelles nous travaillons, mais le volume total devrait atteindre presque 300 agneaux via tous les modes de distribution », précise le responsable professionnel. C'est encore un volume modeste mais on constate une progression régulière de la production. « Cette viande est agréée par la marque Is(h)ere, précise-t-il, et le principal lieu d'abattage est l'abattoir du Fontanil. Notre but est d'être le plus local possible dans la démarche. »
Suspicion

Les dynamiques sont réelles en alpage, mais le resteront-elles ? C'est évidemment la question qui se pose avec la présence du loup qui n'a pas manqué d'être abordée. Car désormais tous les troupeaux sont touchés. Une meilleure protection des troupeaux ovins (ceux qui persistent...) a mécaniquement reporté la pression sur les bovins. Mais tous les responsables d'alpage, éleveurs, bergers, sont unanimes : « nous n'avons que des suspicions et pas de constats nets. » Il est très difficile sur les bovins d'en avoir, car les loups les tuent ou les blessent moins facilement que des ovins, par définition proies plus faciles. Mais certains indices ne trompent pas les éleveurs : quand tout d'un coup du jour au lendemain, une ou deux bêtes ont un comportement apeuré, totalement différent de ce qu'elles avaient avant, qu'elles ne veulent plus revenir dans un secteur de l'alpage, ou bien que plusieurs ont déroché, c'est signé. Un loup les a poursuivi et si l'épisode ne s'est pas terminé par un accident (fracture de mâchoires, de bassin, de pattes) leur comportement est de toute façon difficilement gérable. Cette difficulté de reconnaissance pour les éleveurs par l'administration les plonge dans une colère froide mêlée à de l'incompréhension. Certains l'ont exprimé devant Mme Bozonnet. Si d'autres ne voyaient comme solution que le recours au fusil et à une justice expéditive vis-à-vis du loup, la directrice de la DDT, les en a dissuadé fermement : « ces actes relèvent du pénal, des poursuites sont déjà engagées dans deux cas. » Mais la représentante de l'Etat se dit attentive : « mon bureau vous est toujours ouvert et nous pouvons revoir des décisions prises (...) la prédation est insupportable. Vous ne devez pas être là pour le loup mais pour vos animaux. Ces paysages sont là grâce à vous, nous ne devons pas les perdre. » Une position entendue par Denis Rebreyend, président de la FAI, qui constate que « l'écoute de la part de l'administration a beaucoup évolué depuis les premières attaques il y a 20 ans. Tout ne peut pas se régler en cinq minutes. Il faut avancer de concert. »