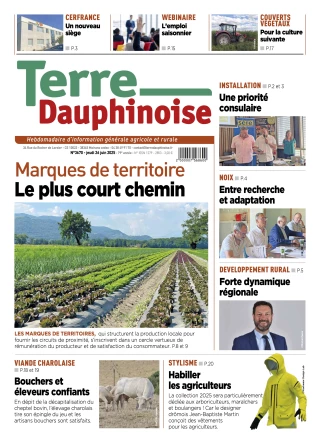Les bénéfices du méteil dans les rotations et les rations

Bon pour les vaches, bon pour l'image. A la tête d'un troupeau de 40 montbéliardes, Patrick Gerin et son frère, éleveurs laitiers à Saint-Jean-de Bournay, ne tarissent pas d'éloge envers les méteils. Ils les ont introduit dans la ration fourragère de leurs animaux il y a quatre ans et ne le regrettent pas. « La production a légèrement baissé, mais nous avons sécurisé l'élevage du point de vue sanitaire », explique le gérant du Gaec de Mayolans. Du côté d'Isère Conseil Elevage, on confirme : « C'est un produit qui favorise la rumination des animaux, plus riche en cellulose, et moins riche en sucre et en amidon. Il y a donc moins de risque d'acidose », explique Michaël Bonnault, conseiller élevage au Contrôle laitier. Propos corrboré par le Pep Bovins lait : « Le méteil constitue une sécurité « fibres » pour limiter l'acidose, affirme Emmanuel Forel, de la chambre d'agriculture de l'Ardèche. Il remplace avantageusement la paille du foin ou la luzerne brin long. » C'est en effet un fourrage qui, en apportant de la fibre (170 g de cellulose par kg de matière sèche), favorise la rumination des animaux (plus de cellulose, moins de sucre et moins d'amidon). Et comme il fournit une grosse quantité de fourrage en une seule coupe, le méteil permet également de sécuriser les stocks, et donc d'accroître l'autonomie fourragère de l'exploitation. « C'est un système qui marche bien, même s'il est gourmand en main-d'œuvre, juge Patrick Gerin. Pour nous, qui vendons 30 000 litres de lait en vente directe, cela donne l'image d'une agriculture autonome qui sait concilier approche environnementale et valorisation des productions de l'exploitation. »
Solution économe en phyto
Au Gaec de Mayolans (90 hectares, deux UTH), l'adoption du méteil ne doit rien au hasard. Installés en zone de captage, les Gerin travaillent depuis longtemps à développer des techniques susceptibles de diminuer l'usage de produits phytosanitaires (travail du sol, fauche de la luzerne, binages du maïs, herse étrille sur le blé...). Ils pratiquent des cultures peu consommatrices de phyto et essentiellement destinées au troupeau. Leur rotation (maïs, blé, orge) est coupée par une interculture de luzerne. Et s'ils s'autorisent de l'anti-limaces au début des rotations de luzerne et de maïs, voire un fongicide en préventif sur le blé, ils ne recourent aux herbicides que si c'est vraiment nécessaire. Cette démarche vertueuse les a conduits à rejoindre le réseau Ecophyto et à mettre en place des mesures agro-environnementales (MAE), qui leur apportent une assurance financière... jusqu'à la fin de l'année. L'adoption du méteil s'inscrit donc dans une suite logique.
Le « virage » a été négocié en 2010. Documentation et conseils de techniciens aidant, cette nouvelle culture fourragère, constituée d'un mélange de céréales et de protéagineux, correspondait bien aux objectifs des éleveurs. Simple à conduire, elle n'a besoin que d'un peu d'azote et ne nécessite aucun traitement. Les Gerin sèment leur méteil en combiné vers la mi-octobre, lui apportent 15 tonnes de fumier à l'hectare et 50 unités d'azote au printemps. « On sème et on récolte », assure Patrick Gerin. Il n'y a pas de désherbage à prévoir : « On peut avoir des plantules, mais il y a tellement de végétation que ça crève dessous ! »
Econome en intrants et en produits phyto, le méteil a par ailleurs un effet bénéfique sur le sol et sa structure (biomasse racinaire, capacité à fixer l'azote). De plus, son rendement est régulier et plutôt bon (entre 8 et 11 MS/ha). Le Gaec de Mayolans a même enregistré un excellent rendement de l'ensilage méteil en 2013. C'est donc une culture qui se valorise très bien. L'éleveur tient cependant à mettre un petit « bémol », en raison du coup assez élevé des semences de légumineuses (entre 150 et 180 euros l'hectare).
S'il y a peu d'intérêt à récolter trop tôt (moins de matière sèche), les éleveurs recommandent de ne pas trop attendre non plus : « Si on attend trop pour chercher à obtenir plus d'amidon, on risque d'avoir un ensilage trop riche en matière sèche. » Le bon compromis se situe autour de 25% de matière sèche, ce qui en année « normale », correspond à une récolte fin mai début juin.
Un fourrage appétent et fibreux
Concernant l'alimentation des bêtes, le méteil est un fourrage globalement équilibré et riche en fibres. Sa valeur nutritive se rapproche d'un bon foin de première coupe. Il présente un bon équilibre énergie/azote (pas d'azote soluble) qui permet de couvrir les besoins des vaches allaitantes, des gestantes et des génisses. Pour les vaches laitières, il constitue « un fourrage appètent et fibreux », idéal en complément dans une ration de maïs ensilage, mais « tout dépend du stade de récolte », prévient Patrick Gerin. « D'octobre à mars, avec le méteil, on a de très bons résultats sur le plan cellulaire, poursuit l'éleveur. Sa digestibilité est bonne et il y a moins de risque d'Esherichia coli. » Certes, la quantité de lait produite est un peu inférieure à un « régime maïs » : 21,2 kg de lait en moyenne par vaches avec une ration type méteil contre 23,6 pour une ration type maïs selon un essai d'alimentation réalisé par le Pep Bovins lait au cours de l'hiver 2009-2010 sur deux lots de montbéliardes (1). Mais il reste néanmoins très intéressant (8 200 litres de lait par vache au Gaec de Mayolans).
Enfin, le Contrôle laitier rappelle que le méteil peut s'intégrer soit dans une stratégie « trou d'été », soit dans une stratégie de stock fourrager. Emmanuel Forel ajoute qu'une association méteil/herbe peut être « une alternative intéressante, notamment l'été. Mais pour garantir son succès, il faudra assurer une bonne transition alimentaire et corriger la ration en énergie et azote » (2).
(1) Un lot nourri avec des rations constituées d'ensilage maïs, complété d'ensilage herbe, de céréales et de tourteau de colza, l'autre d'ensilage méteil, complété avec les mêmes éléments, dans les mêmes proportions.
(2) Pour une ration moitié ensilage herbe, moitié méteil : 4 kg de céréales et 2,5 kg de tourteau de colza pour viser 25 litres de lait.