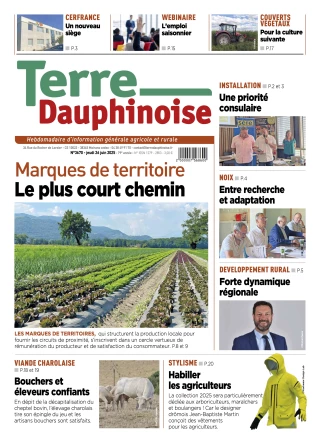Les très grosses réserves foncières du Lyon-Turin

Y aura-t-il encore des vaches en Nord-Isère en 2030 pour regarder passer les trains ? Rien n'est moins sûr, tant le nord du département croule sous les projets d'infrastructures.
La DTA de Saint-Exupéry, en cours de révision, est aujourd'hui rattrapée par le projet de la LGV Lyon-Turin.
Très discrètement, ce dernier a profité du train de la loi montagne promulguée le 28 décembre dernier, pour marquer un peu plus son ancrage dans le paysage régional.
Le dernier article - article 95 - donne en effet « tous les droits » à la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin « pour l'acquisition, au nom et pour le compte de l'Etat, des terrains nécessaires (...) à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière ».
Il faut dire que depuis l'été dernier, les choses vont bon train du côté du tunnel de base, sur le site de Saint-Martin-la-Porte en Savoie. L'ouvrage d'un montant de 8,6 milliards d'euros a démarré avec l'arrivée sur place du tunnelier Fédérica. D'ici à 2029, il lui reste 57 km à creuser avant de déboucher dans la vallée de Suse en Italie.
900 hectares
Rappelons que la LGV Lyon-Turin est un ouvrage de 140 km qui traverse trois départements et deux pays. Il passe par 73 communes dont 41 en surface.
Le projet se décompose en deux parties.
La première phase est la réalisation d'une ligne de fret et de voyageurs de 78 km entre Lyon et Chambéry. Son montant s'élève à 4,5 milliards d'euros.
La deuxième étape est un itinéraire fret de 62 km entre Avressieux et Saint-Jean-de-Maurienne, enterrée à 87% et passant sous les massifs de Chartreuse et de Belledonne. Il en coûtera 3,2 milliards d'euros.
Lors d'une réunion qui s'est déroulée fin janvier sur l'initiative du sous-préfet de La Tour-du-Pin, SNCF Réseau, maître d'ouvrage des itinéraires d'accès au tunnel franco-italien qui ont été déclarés d'utilité publique (DUP) par décret du 23 août 2013, a proposé un état des lieux du projet.
Au cœur des enjeux, il a été révélé que le portage foncier concernerait environ 900 hectares prélevés dans les départements du Rhône, de l'Isère et de la Savoie.
Le Nord-Isère serait impacté entre 250 et 270 hectares.
Les réserves foncières(1) pourraient être engagées à partir du deuxième semestre 2017.
Compensations environnementales
« 120 exploitations sont concernées en Isère », rapporte André Coppard, élu à la chambre d'agriculture de l'Isère en charge du dossier.
Les organismes consulaires agricoles des trois départements s'intéressent plus particulièrement aux trois thématiques que sont les réserves foncières, les compensations environnementales et la gestion des dépôts de matériaux. Vu la taille des tunnels, c'est un vrai problème.
« La Savoie est la plus concernée, mais on parle de centaines d'hectares », annonce André Coppard, qui propose de penser à combler les carrières qui mitent le secteur.
Il reprend : « Les trois chambres ont demandé à ce que la Safer porte le foncier agricole, le foncier à usage environnemental étant confié à l'Epora et l'EPFL. »
Une réunion est organisée en préfecture de l'Isère en fin de semaine à ce sujet.
Ce qui fait trembler le monde agricole est la question de la compensation environnementale.
« Le préfet de Savoie, qui coordonne le dossier du Lyon-Turin, s'est engagé à ce qu'il ne soit pas prélevé de terres agricoles pour les compensations environnementales », relève le représentant de la chambre d'agriculture.
Le tracé de la LGV traverse en effet le marais d'Avressière en Savoie ainsi que deux zones Natura 2000.
L'actuel Sdage (loi sur l'eau) prévoyait pour les zones humides une compensation de un pour deux avec 50% sur le même bassin.
Sa révision, à partir de 2018, en raison des difficultés de sa mise en œuvre, à l'image du projet Center parcs, pourrait revenir à des proportions de un pour un, avec la prise en compte d'éléments quantitatifs ou surfaciques.
Triple peine
La question est de savoir comment l'Etat va gérer les compensations foncières, agricoles et environnementales.
D'après le dernier rapport d'orientation de l'Epora, l'établissement en charge de gérer le patrimoine foncier de l'Etat dans le secteur, en manque de ressources verrait « le produit des cessions » observer une « progression sensible ».
L'Etat prévoirait en effet de vendre une bonne partie de ses terres ; une opération qui tombe à point nommé quand le Lyon-Turin vient interroger l'échiquier foncier du Nord-Isère.
Le risque : la double, voire la triple peine pour les exploitations agricoles du Nord-Isère.
Impact de la ligne, impact de ce qui en découle, le projet ravive le traumatisme de 1971.
Car le secteur porte encore les stigmates du projet pharaonique de la Ville nouvelle de l'Isle d'Abeau qui « a été l'occasion d'une démonstration paroxystique des moyens et des chemins de l'urbanisme d'Etat... et de son manque profond de sens politique (...) », est-il consigné dans une évaluation des villes nouvelles commandée par le ministère de l'Equipement en 2002 (2).
Le nœud de la crispation réside dans « le rachat à bas prix des terres agricoles qui a suscité l'opposition de la population », est-il précisé.
50 ans de précarité
Le sous-préfet de la Tour-du-Pin annonçait que l'Etat était encore propriétaire de 1 500 hectares dans le secteur. Selon le rapport de 2004, les propriétés de l'Etat s'étendraient plutôt sur 2 500 hectares. Un inventaire s'impose.
La crainte, pour les nombreux exploitants agricoles, qui sont sur des baux précaires depuis près de 50 ans, c'est que l'Etat décide de façon directive des compensations foncières.
Nicolas Agresti, directeur de la Safer Isère, estime qu'« un tiers à la moitié des surfaces agricoles dont l'Etat est propriétaire, seraient concernées ».
Il reprend : « Les occupations sont très anciennes et il ne s'agirait pas de retirer des surfaces agricoles pour les confier à un autre agriculteur. »
Pour André Coppard, la situation mérite un examen soutenu.
« Depuis presque 50 ans, c'est parfois une troisième génération d'agriculteurs qui exploitent ces terres. On ne peut pas dire que c'est du précaire. » Il insiste : « Une convention précaire, au bout de 50 ans, c'est plus du précaire ! Il conviendra d'indemniser les agriculteurs comme s'il s'agissait d'exploitants qui ont un bail. »
D'autant que le représentant de la chambre d'agriculture affirme que certaines exploitations pourraient se voir amputer d'une cinquantaine d'hectares « sans leur donner la possibilité de continuer à vivre. Comment va-t-on faire avec de telles surfaces ? »
Il ajoute : « de nombreuse exploitations sont touchées par plusieurs projets. Il faut avoir une réflexion globale ».
Et la situation peut à terme flirter avec l'absurde : réserver d'anciennes terres déjà préemptées pour la Ville nouvelle au profit d'un chantier qui ne verra pas le jour avant une quinzaine d'années dans le meilleur de cas.
Politique foncière
En tous les cas, la question n'a pas encore été portée au Scot Nord-Isère, actuellement en cours de révision.
Seul le fuseau de la LGV figure sur le futur document, ainsi que fléchage foncier de la DTA de Saint-Exupéry et l'identification de le plaine d'Heyrieux pour les mesures compensatoires.
La DUP serait-elle intervenue trop tôt comparé au temps long du chantier ?
Pour l'heure, avec l'accord du département, la Safer a déjà constitué une soixantaine d'hectares de réserves foncières dans le secteur de Bourgoin-Jallieu.
Ces stocks sont destinés à compenser les projets ferroviaires ou d'infrastructures routières.
Lorsqu'un accord interviendra entre les parties sur les modalités de portage du foncier, une convention pourra intervenir dès 2017 avec le lancement d'une politique foncière courant 2017-2018.
Les maires des communes concernées par le tracé de la ligne ont été informés. Il leur reviendra de mettre leurs plans locaux d'urbanisme (PLU) en correspondance.
Une échelle pertinente pourrait être celle de l'intercommunalité, à l'image de la réflexion déjà engagée à la Capi sur le PAEN(3).
Reste l'énormité du projet qui requiert toute la mobilisation du monde agricole.
Isabelle Doucet
(1) Une « commission de concertation interdépartementale relative au foncier et aux activités agricoles impactées par la réalisation de la ligne Lyon-Turin » a été mise en place en 2013.
(2) Ministère de l'Equipement, Programme consacré à l'histoire et à l'évaluation des villes Nouvelles françaises, La Ville Nouvelle De L'Isle d'Abeau Origines, Evolutions Et Perspectives, UPMF, mai 2004
(3) Périmètre agricole et naturel
Chantier
Un tracé à travers le Nord-Isère
La ligne LGV Lyon-Turin démarre au sud de Satolas par le pôle d'interconnexion entre la LGV Paris-Marseille, la ligne Lyon-Grenoble et le contournement de Lyon.Elle traverse ensuite la zone d'activité de Chesne puis la plaine agricole de la Bourbre et du Catelan.
Elle contourne l'Isle-d'Abeau et Bourgoin-Jallieu par le nord en s'engouffre dans le tunnel de Bourgoin sur une distance de 7 km.
Elle ressort à Ruy et franchit l'A43. Un premier raccordement avec la ligne descendant vers Grenoble est réalisé au niveau de Saint-Victor-de-Cessieu.
La ligne se déploie ensuite à travers 2 km de tunnel au niveau de Sainte-Blandine où elle débouche sur un deuxième raccordement avec la ligne de Grenoble.
Elle emprunte à nouveau 7,5 km de tunnel à La Bâtie-Mongascon et débouche à Fitilieu pour suivre l'A43.

Elle emprunte alors deux viaducs, à Chimilin et au-dessus du Giers, avant de traverser le marais d'Avressieux en Savoie.
Elle s'engouffre dans 15 km de tunnel au niveau des massifs de Dullin et de l'Epine avant d'arriver à Chambéry où elle se raccorde au réseau existant.
Dans un deuxième temps, une ligne uniquement dédiée au fret sera créée à partir d'Avressieux.
Elle consiste en le creusement d'un tunnel de 25 km sous la Chartreuse.
A sa sortie en Combe de Savoie, la ligne traverse une zone Natura 2000 puis rejoint la ligne Grenoble-Montmélian et reprend sa course à travers le tunnel de Belledonne d'une longueur de 20 km.
Elle ressort à Saint-Rémy-de-Maurienne, longe une nouvelle zone Natura 2000 puis emprunte le Tunnel des Cartières et celui du Glandon sur 10 km.
Elle arrive à Saint-Jean-de-Maurienne pour rejoindre le tunnel de base de la section internationale.
A lire aussi :