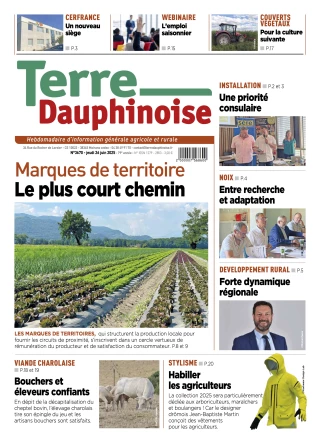Méteil : produire ses protéines

« Le méteil ? C'est une culture de fainéant ! » David Gros-Flandre, éleveur laitier à Massieu, a la plaisanterie facile. Mais sa boutade n'est pas dénuée de fondement. Lorsque ses associés du Gaec des Grands Prés, Gilles et Isabelle Costa-Roch, et lui ont décidé de se convertir au bio il y a trois ans, ils se sont tout de suite intéressés au méteil. « C'est une culture qui n'est pas bien exigeante en termes de conduite technique et de temps de travail », justifie Gilles Costa-Roch. Les éleveurs ne réalisent aucune intervention entre le semis et la récolte « à part un part un passage de herse étrille en sortie d'hiver si les conditions le permettent », précise Gilles, et « un passage de bineuse dans l'idéal », complète David.

Culture économe
En conventionnel ou en bio, les éleveurs qui choisissent de cultiver du méteil se retrouvent autour d'une même problématique : réduire la dépendance en protéine et s'engager dans « une culture plus économe que le maïs », afin d'obtenir la meilleure marge possible à l'échelle de l'exploitation. Max Gros-Balthazard trouvait que « les rations à base de maïs-ensilage/tourteau coûtaient cher à produire ». Il a donc cherché une culture économe qui lui permette de « produire un maximum de protéines ». Idem au Gaec des Grands Prés où les éleveurs voulaient « augmenter le taux d'autonomie protéique et le rendement ». Quant à Alain Ginier-Gillet, éleveur de brebis à Saint-Pierre-de Bressieux, il se sert des méteils pour « varier les sources de protéines » qu'il donne à ses brebis en lactation comme à ses agneaux à l'engraissement.
Lors du "rallye méteil" organisé le 7 juillet dernier par le réseau Dephy et l'Adabio, tous les éleveurs se sont accordés sur le triple intérêt des méteils : amélioration de l'indépendance protéinique, facilité de conduite et coût de production relativement faible. Certes, reconnaît David Gros-Flandre, « les semences sont un peu plus chères au départ, mais comme le méteil nécessite moins d'intervention, moins de fertilisation et aucun phyto, c'est environ trois fois moins cher que le maïs ». Max Gros-Balthazard, éleveur laitier conventionnel à Rives, a lui aussi introduit les méteils dans son assolement. Il confirme : « Pas besoin d'herbicide ni de fongicide, car les méteils sont suffisamment couvrants vis-à-vis des adventices et résistent aux maladies. »
Passer de la monoculture de maïs aux méteils ne se fait cependant pas sur un claquement de doigt. « Il a fallu tout repenser, raconte David Gros-Flandre. Nous sommes d'abord passé par la luzerne - ça n'a pas marché. Puis nous avons combiné ray-gras en dérobée - maïs ensilage, avant de basculer sur le méteil. » Les deux premières années, Gilles et David ont ensilé une partie du méteil au stade pâteux de la céréale (autour du 15 juin), mais ils ont arrêté car les valeurs protéiques du fourrage (autour de 11%) ne les satisfaisaient pas. Ils sont revenus au méteil sec. Les rations données aux vaches sont désormais constituées de 75% de méteil et de 25% de soja. « Nous voulons un mélange à 18% de protéine, explique David Gros-Flandre. Jusqu'à présent on était bloqué à 15-16. Alors on cherche, on affine... On essaie de gagner deux points de protéine en jouant sur la féverole. »

Trouver le bon mélange
Pas simple. Cette année, les deux associés ont fait un essai en semant autour du 20 octobre un mélange de triticale (130 kg/ha) et de féverole (50 kg/ha). Sur une autre parcelle, ils ont testé un cocktail de triticale (150 kg/ha), avoine (50 kg/ha) et pois (25 kg/ha). Pour la féverole, le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes. « C'est hyper pointu... On tâtonne pour trouver le bon mélange en fonction de la bonne parcelle, reconnaît David. On mettra un peu plus de protéagineux l'an prochain. » En revanche, sur leurs terres, le « mélange courant » de triticale (150 kg/ha) et de pois (12,5 kg/ha de pois fourrager et 12,5 kg/ha de pois protéagineux) fait figure de valeur sûre. Cette année, les éleveurs ont d'ailleurs augmenté leur densité de semis pour monter à 200 kg/ha au total (175 kg de triticale pour 25 kg de pois), contre 170 kg/ha auparavant. Pourquoi ce choix ? « Dans notre contexte d'hivers assez rudes, les triticales tallent peu, ce qui ne permettait pas d'avoir une couverture du sol suffisante en sortie d'hiver », indique Gilles Costa-Roch. Et l'éleveur de préciser qu'il cherche deux hauteurs de pois : une basse (pois protéagineux) pour couvrir et limiter la verse, et une haute (pois fourrager) pour obtenir du rendement. De ce point de vue, tous les éleveurs se disent satisfaits des rendements réguliers des méteils (autour de 40 q/ha), avec 40 à 50% de pois à la récolte.
Semences fermières
A Rives, Max Gros-Balthazard est parti sur un mélange plus complexe. Fin octobre début novembre, il a semé derrière le maïs un mélange issu de semences fermières d'un précédent méteil. Ce mélange (180 kg/ha) est constitué de triticale (60kg), d'avoine (25kg), 60 kg de pois protéagineux, 25 kg de vesce, 25 kg d'avoine et 10 kg de féverole. « Au niveau des légumineuses, j'ai choisi d'associer pois, vesce et féverole pour apporter de la diversité à la fois au niveau de la culture et au niveau des types d'amidon et de protéines qui seront apportés à mes vaches. La vesce est intéressante, car elle occupe bien l'espace et permet de boucher les trous dans la parcelle s'il y en a. » Le problème, c'est qu'elle peut prendre le dessus... et tout faire verser, comme en témoigne la parcelle en ce début juillet.
Au final, difficile de préconiser un mélange plutôt qu'un autre. Tout dépend de la parcelle, du climat, du type de sol... Pour David Stéphany, technicien à l'Adabio, « il faut partir sur des mélanges les plus complexes possibles pour être sûr qu'il sorte quelque chose », quitte à cibler les protéagineux pour apporter de la valeur protéique. Cette complexité est d'autant plus intéressante qu'elle désarçonne les prédateurs : « Il y a moins d'attaque, car les bestioles n'arrivent pas à savoir ce qu'il va y avoir à manger », témoigne David Gros-Flandre. Une incertitude qui n'est pas sans affecter les éleveurs eux-mêmes : « L'inconvénient du méteil réside dans la difficulté à maîtriser les proportions de céréales et de légumineuses à la récolte d'une année sur l'autre, juge Max Gros-Balthazard. Les rendements sont très réguliers, la composition du mélange à la récolte l'est beaucoup mois. Avec le méteil, c'est un peu inch'Allah ! »
Marianne Boilève
Témoignage vidéo : Serge Desvignes nourrit ses montbéliardes avec du méteil.
Quels protéagineux en complément du pois fourrager et de la vesce ? Cliquer ici