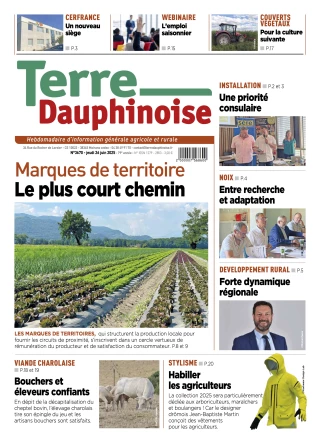Tempête dans une zone vulnérable

Comment quatorze communes ont-elles bien pu se retrouver propulsées en zone vulnérable au titre de la directive nitrates avec une telle légèreté ? C'est ce que les élus de la chambre d'agriculture de l'Isère ne cessent de se demander. Réunis en session vendredi dernier, ils ont voté une motion contre l'extension de cette zone en Isère. Sur le fond, ils rejettent le mode de calcul, qui vise à établir un seuil de 18mg/l de concentration de nitrates dans les analyses opérées dans les eaux de surfaces. Ce seuil était de 50mg/l auparavant. De plus, ils trouvent aberrant que les analyses portent désormais sur les eaux de surface alors qu'elles concernaient auparavant les eaux souterraines. « Le nombre d'analyses ou d'observations est insuffisant » est-il également souligné dans la motion, de même qu'il n'a pas été tenu compte des nombreuses dispositions déjà prises par les agriculteurs. Surtout, il est pointé que dans nombre de communes proposées à l'extension, l'origine non agricole de la pollution ne fait aucun doute.

Pollutions domestiques
La commune de Varacieux est devenue le symbole de cet à-peu-près qui a prévalu au classement des nouvelles surfaces. Elle rejoint en effet la liste sur la foi du diagnostic du Contrat de rivière du Grésivaudan établi en 2012 et d'un seul point de prélèvement apportant une très forte variabilité (de 0,8 mg/l à 21 mg/l). En outre, ces prélèvements mettent « en évidence des problématiques non agricoles importantes sur ce bassin ».
En effet, en amont du bassin de la Cumane, les problèmes sanitaires étaient déjà bien connus et identifiés comme domestiques, en raison de la nécessaire rénovation de la station d'épuration Aqualline, à Saint-Sauveur, inaugurée le 20 septembre dernier. Depuis, il n'a été procédé à aucune nouvelle étude. Les agriculteurs pointent également le déficit hydrique chronique de la Cumane, de nature à rendre très incertaine la fiabilité des mesures. L'origine des pollutions, n'a pas non plus été clairement établie pour les communes de La Forteresse, Plan, Quincieu et Saint-Geoirs, situées en amont du bassin versant du Rival. De fortes suspicions portent sur les stations d'épuration d'Izeaux-Sillans, de La Côte-Saint-André-Le Rival et de Saint-Siméon-de-Bressieux. De plus, les contaminations en nitrates des eaux superficielles du Rival et de l'Oron sont très faibles.
Une seule valeur
D'autres communes ont été classées en raison de la règle du percentile 90, qui veut que la valeur maximale soit retenue lorsqu'il existe moins de dix mesures. Dans ces études menées en 2011, une seule valeur était supérieure à 18 mg/l. C'est le cas de Tullins, dont une faible part du territoire de la communes intéresse la bassin de la Fure. Mais surtout, le bilan du contrat rivière pour le bassin Paladru-Fure indique une pression domestique de l'assainissement non collectif sur le bassin et des données récentes (2012 et 2013) montrent que la teneur maximale ne dépasse par 15,5 mg/l sur le point de référence de Tullins. Les communes des Avenières, Le Bouchage, Brangues, Corbelin, Morestel, Saint-Victor-de-Morestel, Vezeronce-Curtin, et Veyrins-Thuellin, n'ont elles aussi, dans le cadre d'une analyse opérée en janvier 2011 et selon la règle du percentile 90, qu'une seule valeur supérieure à 18mg/l. Depuis, 21 nouvelles mesures ont été effectuées et aucune ne dépasse 18mg/l.

En deux temps
L'ensemble de ces communes fait l'objet d'une demande de révision auprès des ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie, de la part du préfet de région, coordonnateur du bassin Rhône-Méditerrannée. Le représentant de l'Etat sollicite donc l'exclusion de ces communes de l'extension des zones vulnérables. Il pourra désormais étayer sa demande par les avis rendus par le conseil général de l'Isère et la chambre d'agriculture. Pour Christian Nucci, vice-président du conseil général en charge de l'agriculture, les préoccupations portent en effet sur la capacité des équipements à caractère public pour le traitement des pollutions domestiques. « Pourquoi faire porter une réponse à l'agriculture sur une question qui ne lui incombe pas », interroge-t-il. Cependant, la profession doit faire face à certaines oppositions. Fin octobre, les membres du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) s'étaient prononcés pour l'extension de cette zone vulnérable, à une voix près. Une douche froide. « L'association des maires de l'Isère s'est abstenue », indique Jérôme Crozat, élu de la chambre d'agriculture, qui exhorte de « travailler main dans la main avec les maires car nous avons besoin de bonnes liaisons entre l'Ami et la profession agricole ». Mais c'eût été reconnaître, de la part des édiles, qu'il y a encore fort à faire en matière d'assainissement en Isère. De plus, la tendance est au verdissement, en Europe, en France, et à l'échelle locale.
Fortement interpelée par les agriculteurs à ce sujet, Marie-Claire Bozonnet, directrice de la DDT, s'est expliquée quant à son vote en Coderst en faveur de l'extension de la zone, déclarant qu'en tant que fonctionnaire, elle n'avait « pas la liberté de choisir », que la commission ne donnait qu'un avis sur un périmètre et qu'aujourd'hui nous étions « au-delà du Coderst ». Ce raisonnement en deux temps explique que désormais le DDT se range aux conclusions techniques de la chambre d'agriculture et du conseil général, reconnaissant que « oui, dans un grand nombre de cas, nous avons des soucis d'assainissement », pour émettre un avis négatif sur l'extension de la zone...

« Jeu mortel »
Pour Pascal Denolly, le président de la FDSEA, « il est désormais impossible de demander à une profession de s'adapter en ne donnant aucune visibilité sur le long terme ». Pour protester contre ce zonage, il se réserve « la capacité d'un dépôt de plainte devant le tribunal ». Il estime que le changement des règles du jeu le transforme en « jeu mortel » pour les agriculteurs, en raison des conséquences que ces nouvelles règles pourraient avoir sur les exploitations. La FDSEA a également déposé une motion sur l'application du 5ème programme de la directive nitrates, demandant un délai de deux ans pour la mise aux normes de leurs capacités de stockage, une prorogation du délai de réception des déclarations d'intention de mise aux normes jusqu'au 31 décembre 2014 et un accompagnement des agriculteurs pour limiter leurs investissements. Seul point positif abordé par les élus de la chambre et les représentants de l'administration : la règle des épandages organiques sur les pentes pourrait évoluer favorablement.